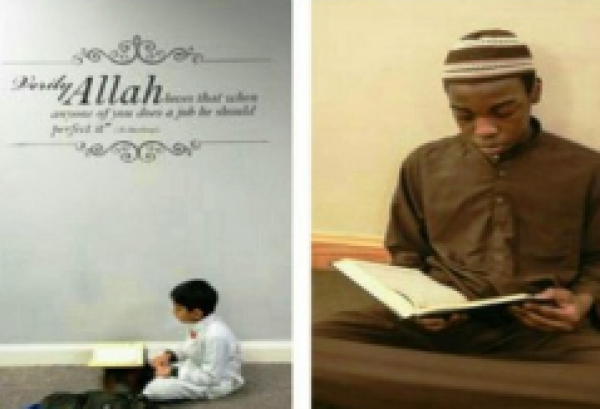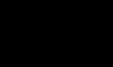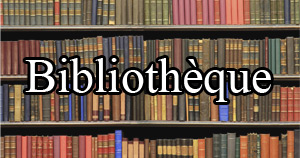Face à la montée en puissance de l’économie chinoise, les Etats-Unis se doivent de réagir pour survivre. Le projet de réforme fiscale de Donald Trump, qui visait à encourager la production intérieure, a été rejeté par le Congrès, qui a préféré protéger les profits des multinationales. C’est pourquoi, la Maison-Blanche n’a plus d’autre choix que de saboter les investissements de Beijing pour la création de nouvelles voies de communication et l’exportation globale de ses produits.
تقي زاده
Ce qu'a changé le veto du 26 février de la Russie
L'intense campagne médiatique autour de la Ghouta orientale où les Américains cherchent à renforcer les terroristes pour investir la banlieue de la capitale syrienne a presque éclipsé un événement majeur : le veto russe au Conseil de sécurité des Nations unies, lundi, destiné à bloquer une résolution franco-anglo-saxonne condamnant l’Iran. Son motif? La violation présumée des sanctions que l'Occident impose depuis 2015 au peuple yéménite, victime à la fois de l'agression saoudienne et de complicité criminelle des marchands d'armes occidentaux.

Le veto russe a été sans précédent : pour la première fois dans l'histoire du droit international, la Russie a rejeté au Conseil de sécurité une initiative dirigée par les Américains au sujet d'un conflit régional où elle n'est pas partie prenante. On se rappelle fort bien de l'indifférence russe en 2003 quand les États-Unis ont fait voter leur action militaire contre l’Irak ou leur apathie en 2011 au moment où l'OTAN préparait son plan d'invasion de la Libye. Dans l'un et l'autre cas, les intérêts russes étaient toutefois impliqués, mais Moscou avait choisi de s'abstenir. C'est qu'à l'époque les Russes avaient peut-être leur mot à dire, mais ils n'étaient pas suffisamment forts.
Selon des experts, le veto russe de lundi dernier entre dans une catégorie à lui seul, qui renvoie à "l’impasse russo-américaine en matière d’influence mondiale". Il s'agit donc d'un réel tournant dans l’après-guerre froide qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur.
Le texte que la Grande-Bretagne de May avait proposé contre l'Iran a été des plus puérils : Londres, Paris et Washington, qui occupent le peloton des pays vendeurs d'armes au régime de Riyad, ne s'étaient pas même souciés de fournir la moindre preuve empirique sur "le soutien iranien " aux Houthis qui subissent comme une majorité de Yéménites, un blocus maritime, terrestre et aérien total depuis bientôt trois ans. Il n'était donc pas question pour la Russie de se laisser faire.
Le veto historique de Moscou a fait passer un message à plusieurs niveaux
Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ne peuvent plus dominer le système international, car la Russie est désormais déterminée à s’opposer par principe à l’hégémonie américaine. À vrai dire, la Russie de Poutine a très bien vu où voulait en venir l'Amérique de Trump, en poussant Londres et Paris à jouer son jeu au Conseil de sécurité. La résolution anti-iranienne visait moins les Houthis pour leur supposée alliance avec l'Iran que l'Iran lui-même. Après s'être presque retirés de l'accord nucléaire signé en 2015 avec l'Iran, les USA comptaient sur ce vote pour faire condamner les missiles conventionnels iraniens.
La démarche de Moscou a fait échouer une tentative peu scrupuleuse de l’Occident consistant à isoler l’Iran en terme géopolitique, comme le souhaitent les Américains. Pour le reste, la position occidentale à l'égard du conflit yéménite est on ne peut plus cynique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France participent virtuellement au conflit en fournissant une assistance militaire aux forces saoudiennes et en identifiant pour elles les cibles de leurs attaques aériennes brutales et accusent l'Iran d'ingérence.
Ce qui ressort en dernier lieu de cette analyse, c’est aussi la résilience de l’alliance russo-iranienne dans la politique du Moyen-Orient. La thèse occidentale selon laquelle un Iran « monté en puissance » s’opposera à la Russie au Moyen-Orient ne tient donc pas debout. Lundi dernier, La Russie a fait part de ses qualités uniques pour jouer un rôle d'arbitre non seulement dans la fin du conflit au Yémen, mais aussi dans ce qui pourrait être qualifié de "fin de l'unilatéralisme". Dans un geste de défi d'une rare violence, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov a affirmé mardi à Moscou qu' « il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre le Plan d’action global conjoint [l’accord nucléaire iranien]. S’il y a une volonté de discuter d’autres questions concernant l’Iran dans ce format ou dans un autre format, cela devrait se faire avec la participation volontaire de l’Iran et sur la base du consensus plutôt que par le biais d’ultimatums. »
Si la France de M. Macron qui envoie dès ce dimanche son chef de la diplomatie en Iran croit pouvoir, sur les pas de Washington, reproduire le scénario à la libyenne en Iran, elle se trompe lourdement: il ne suffit plus de faire voter des textes au Conseil de sécurité pour déposséder les États souverains de leur souveraineté.
L'Iran abandonnera son programme balistique si l'Amérique et l'Europe en font autant
La condition des négociations sur le programme balistique de l’Iran est la destruction des armes nucléaires et des missiles à longue portée des États-Unis et de l’Europe, a déclaré le porte-parole et chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes.
Le général de brigade Seyyed Massoud Jazayeri a déclaré : « Ce que les Américains s’acharnent à dire sur la limitation de la puissance balistique de l’Iran trahit les ambitions inassouvies et les échecs des Américains dans la région. »
« Si notre capacité défensive devait être influencée par certaines négociations politiques et diplomatiques, nous ne serions pas dans la position où nous sommes aujourd’hui et les États-Unis ne seraient pas dans une position de faiblesse », a-t-il ajouté.
Conditionnant les négociations sur le programme balistique de l’Iran à la destruction des armes nucléaires et des missiles à longue portée que détiennent les États-Unis et l’Europe, il a indiqué que les Américains cesseront d’essuyer des défaites dans la région lorsque le « grand Satan aura quitté le Moyen-Orient ».
« Au sujet du régime israélien, ce denier occupe illégitimement les territoires palestiniens et la noble Qods ; il se rapproche de l’heure où il s’effondrera et sera aboli », a-t-il martelé.
Le redressement économique de la France "liée au marché iranien"
Pour le site d’information américain francophone, Dreuz, la survie de l’industrie de l’automobile et de l’élevage de la France dépend du marché « lucratif » iranien.
S’attardant sur le fait que les décideurs économiques en France sont « déterminés » dans leur coopération avec l’Iran, cette source précise que « la France fait des pas décisifs dans le processus de rapprochement avec l’Iran, dans une situation de chamboulement dans la région du Moyen-Orient ».

Faisant allusion à la conférence Euro Money 2018, qui s’est tenue à Paris, le 8 février 2018, et qui a été organisée conjointement par la Banque centrale iranienne et l’Euromoney Institute, ce média américain pro-Israël, ajoute que cette réunion « était une occasion pour présenter les opportunités iraniennes d’investissement, particulièrement dans les secteurs du pétrole, du gaz, du tourisme, du transport et des assurances en Iran. C’était également l’occasion de préparer progressivement l’intégration de l’Iran, à l’économie mondiale ».
Depuis le début 2018, les observateurs font état de la multiplication des démarches effectuées par de hauts responsables économiques iraniens pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour consolider les relations entre les deux pays. Information qui n’a jamais été démentie par Paris. De leurs côtés, les décideurs économiques en France semblent déterminés dans leur coopération avec l’Iran.
Joffrey Célestin-Urbain, sous-directeur des relations économiques bilatérales à la direction générale du Trésor en France, a déclaré : « Nous encourageons les sociétés commerciales à poursuivre leurs activités en Iran. »
Selon ce responsable de l’administration centrale du ministère de l’Économie et des Finances, au cours des 11 premiers mois de l’année 2017, les exportations françaises en Iran ont connu une hausse de 120 % pour atteindre 1,29 milliard d’euros et les importations de produits iraniens en France ont eu une croissance de 80 % pour atteindre une valeur de 160 millions d’euros.
Le responsable français a aussi indiqué que la priorité à court terme de la France est la sauvegarde des échanges commerciaux avec l’Iran ainsi que la réalisation d’un nouveau projet pour l’année en cours consistant à offrir des crédits en euro aux acheteurs iraniens de produits français.
Le chef de la Banque centrale iranienne, Valiollah Seif, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqtchi, le président du Conseil supérieur des assurances de l’Iran, Abdolnasser Hemmati, le conseiller aux affaires économiques du président iranien, Masoud Nili, et le président du comité de direction de la Banque Saman, Vali Zarrbieh, ont fait, chacun, un discours lors de cette rencontre parisienne.
Le plus malhonnête dans cette démarche est le manque de transparence des médias français. Après vérification, rares sont les plateformes médiatiques en France qui ont traité le sujet. Pourtant, il existe un calendrier spécial de toutes les conférences avec les pays étrangers. Celle du 8 février, précisément, a été occultée mais largement couverte par les médias iraniens.
Aussi cette démarche conforte-t-elle une récente information publiée par Le Monde, selon lequel le constructeur français Renault et le secteur agonisant de l’élevage en France « ont besoin du marché iranien » pour « pouvoir poursuivre leur redressement ».
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’apprête à se rendre en Iran le 5 mars, mais sa visite n’a pas encore été confirmée par les autorités iraniennes.
Iran : Système anti-aérien Bavar est le cauchemar de nos ennemis
Un haut officier militaire iranien souligne les capacités défensives de la République islamique et met en évidence les caractéristiques du système de missiles antiaériens à longue portée, connu sous le nom de Bavar (confiance) 373, fabriqué dans le pays qui dépasse de 50% la portée du S-300 de Russie.
Agence de Nouvelles d'Ahlul Bait (ABNA) : Le commandant de la base de défense aérienne Khatam Al-Anbia de l'armée iranienne, Farzad Esmaili, a indiqué vendredi que les forces de l'armée et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGR) seraient confrontées aux agressions des ennemis de la République islamique. Pays.
Il a insisté sur le fait que les ennemis conspiraient contre l'Iran, mais il a clairement fait savoir que le pays perse neutraliserait tout plan macabre à cet égard. "Toute action hostile contre l'Iran sera écrasée", a-t-il souligné.
Le haut commandement militaire a dénoncé, en particulier, l'animosité de Washington avec la Révolution islamique d'Iran et a rappelé le soutien des Etats-Unis. Au régime baathiste dans la guerre imposée par l'Irak à l'Iran entre 1980 et 1988.
Ces dernières années, l'Iran a fait des progrès considérables dans le secteur de la défense, malgré les sanctions imposées contre lui. En fait, il a réussi à être autosuffisant dans la production d'équipements militaires et de systèmes essentiels à son système défensif.
La République islamique a affirmé à plusieurs reprises que le développement de sa capacité militaire repose sur une doctrine défensive et ne représente pas une menace pour les pays tiers, en particulier pour ses voisins.
Augmentation des centres de mémorisation coranique en Pennsylvanie
Les cours sont organisés sous la direction de Onas Mohaymen, directeur du centre coranique « Ghoba » et de Nahman Chima, imam d’une mosquée de Philadelphie qui a déclaré que les élèves avant de commencer la mémorisation coranique, apprenaient aussi l’arabe et les règles de lecture.
« Depuis la création de notre centre en 1988, six élèves parmi des centaines d’élèves, ont réussi à mémoriser l’intégralité du Coran. Le dernier en date était un Américain d’origine africaine, en 2010, qui a réussi à mémoriser le Coran », a-t-il dit.
Le centre « Zobaydeh » créé il y a trois ans à Montgomery, est un centre à but non lucratif, composé d’une mosquée et d’une école, dirigé par Abdoullah Bekran, qui a déclaré que ce centre avait été créé pour répondre aux besoins dans le domaine de l’enseignement des sciences islamiques et du Coran.
Le centre de Cherry Hill a commencé aussi des activités coraniques au mois d’août.
Les statistiques du CAIR (Conseil des Relations Américano-Islamiques), montrent que 580 000 musulmans vivent en Pennsylvanie et dans le Delaware, qui ont 175 mosquées et 40 écoles islamiques, et il est prévu que la population musulmane en 2075, soit plus importante que la population chrétienne.
Compétition coranique réservée aux handicapés en Égypte
USA : Impérialisme contre ultra-impérialisme
La dernière réforme fiscale US, promulguée le 22 décembre 2017, s’inscrit en droite ligne des précédentes : elle procède à une redistribution de richesses vers les revenus les plus élevés. Les contribuables les plus riches, représentant 1 % du total, ceux déclarant un revenu supérieur à 500 000 dollars, verront leurs impôts diminuer de 60 milliards de dollars par an, autant que 54 % des États-uniens, ceux gagnant entre 20 000 et 100 000 dollars. Ceux qui ont un revenu compris entre 100 000 et 500 000 dollars bénéficieront d’une baisse de 136 milliards de leurs impôts. Ces contribuables représentent 22,5 % de la population taxable, le même nombre que ceux qui gagnent moins de 20 000 dollars et qui ne pourront se partager que 2,2 milliards, c’est-à-dire 0,15 % des rentrées fiscales [1].
Quant à la taxation des profits internationaux des multinationales, elle s’aligne sur les procédures européennes. Elles ne seront désormais imposées que sur leurs revenus US et non plus mondiaux. L’objectif est que ces profits soient, à l’inverse de la situation précédente, rapatriés sur le territoire national. Pour éviter que la base fiscale des entreprises états-uniennes ne s’érode, en logeant leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, la loi recalcule à la hausse le profit normal des entreprises.
Un changement dans la continuité
La nouvelle loi fait pâle figure vis-à-vis de son modèle. Si en 1981, la réforme signée par Ronald Reagan se montait à 2,9 % du PIB, celle mise en place par Donald Trump se limite à 1 % du Produit Intérieur Brut. De même, les 150 milliards de dollars de ristourne annuelle sont nettement plus modestes que les 312 milliards annuels de l’American Taxplayer Relief Act [2], promulguée par Barack Obama en 2013 et votée conjointement par les Démocrates et les Républicains. Elle prolongeait les mesures prises par G. W. Bush en 2004. Il y a bien consensus entre les deux partis pour une redistribution des richesses vers les hauts revenus, ainsi que pour le renforcement de la détaxation des entreprises.
La réforme s’inscrit dans une tendance qui s’inscrit dans le long terme, dans une politique continue d’allègement des impôts payés par les entreprises, des réformes aussi bien portée par les Républicains que les Démocrates. En 1952, l’impôt sur les sociétés représentait 32 % des revenus fédéraux et l’impôt sur le revenu 42 %. Depuis l’impôt sur les sociétés n’a fait que décliner, ne représentant plus que 9 % des impôts fédéraux, contre 47 % pour l’impôt sur le revenu [3]. Pourtant, cette fois, les Démocrates ont parlé d’escroquerie fiscale et se sont frontalement opposé à la réforme. Leur refus virulent est en fait une opération de déplacement. Elle ne porte pas sur le contenu de la loi adoptée, mais bien sur le projet initial de réforme fiscale qu’il fallait à tout prix stopper.
L’abandon d’une révolution fiscale
Le projet de réforme fiscale, initiée depuis juin 2016 par des députés républicains et portée par l’administration Trump, prévoyait des changements radicaux dans la collecte de l’impôt des entreprises. Notamment, elle envisageait une baisse de l’impôt fédéral sur les sociétés de 35 % à 21 %, une réforme qui a bien été adoptée. Mais, il s’agit d’une baisse qui ne modifie pas profondément le montant de ce qui est réellement versé par les sociétés. Grâce aux niches fiscales, l’impôt effectif tournait déjà autour des 20 %. En supprimant ou en plafonnant nombre d’exemptions, la nouvelle loi impose un taux nominal qui se rapproche du taux réel. Ce faisant, la nouvelle loi rétablit de meilleures conditions de concurrence entre les entreprises en s’attaquant à certains privilèges fiscaux.
Cependant, l’essentiel du Border Adjustment Tax a été abandonné. Il prévoyait une exonération des exportations de biens et de services depuis les USA et imposait une taxation d’un montant de 20 % des importations. Les entreprises qui réalisent leur exploitation sur le territoire états-unien auraient été exonérées, au contraire de celles produisant à l’étranger. Le mécanisme est ouvertement protectionniste.
L’objectif était d’accroître l’activité intérieure et de recentrer les investissements états-uniens sur le territoire national. La détaxation de la production intérieure devait permettre une réindustrialisation du pays, grâce notamment au rapatriement, faiblement taxé, des 3 100 milliards de dollars accumulés à l’étranger par les filiales des multinationales US. Ce projet heurtait de front le processus de division internationale du travail et était cohérent avec les décisions précédentes du président Trump de torpiller le Grand Marché Transatlantique et l’Alena.
Gonfler la bulle boursière
Le Border Adjustment Tax, abandonné mi-2017, a laissé la place, début novembre, à un projet de loi envisageant de taxer, à un taux de 20 %, les importations intergroupes des multinationales étrangères situées sur le sol US, ainsi que celles des filiales étrangères des multinationales états-uniennes. Cette fois, il ne s’agissait pas de taxer toutes les importations, mais seulement les flux entre les unités d’un même groupe présent aux États-Unis [4]. L’objectif était d’éviter qu’un groupe puisse réduire ses profits taxables aux USA en achetant des biens intermédiaires produits par ses filiales à l’étranger et ainsi déplacer la production hors du territoire national. Cette taxe aurait seulement rapporté au Trésor 155 milliards de dollars sur une période de 10 ans, soit 10 fois moins que le Border Adjustment Tax. Cependant, l’objectif était moins dans les rentrées fiscales que dans l’incitation à produire aux USA.
Ce projet n’a pas passé le cap des Assemblées et a laissé la place à une loi fiscale classique favorisant les hauts revenus. Comme dans les réformes précédentes, les capitaux rapatriés, grâce à des taux avantageux, ici de 8 % à 15,5 %, seront seulement des transferts de richesses. Sans opportunité d’investissement, ils iront, de nouveau, gonfler la bulle boursière. Ainsi, fin décembre, 32 grandes entreprises ont déjà annoncé des rachats d’actions, totalisant pas loin de 90 milliards de dollars [5]. Le rapatriement des capitaux, encouragée par la réforme fiscale, tendra à une consolidation de la hausse spectaculaire de 25 % de l’indice Dow Jones durant l’année 2017 ou, du moins, sera un élément s’opposant aux prises de bénéfices, dans un contexte boursier devenu plus instable.
Le président Donald Trump vient de déposer un plan de 1 500 milliards de dollars pour relancer la construction et la rénovation de routes, ponts, et autres aéroports. Le plan connaît des problèmes de financement, si bien que le président allouerait seulement 200 milliards de dollars au budget fédéral, alors que le complément, 1 300 milliards, seraient apportés par le secteur privé et les États fédérés. Le projet n’avait pas pu trouver les financements dans le cadre de la réforme fiscale, suite à l’opposition démocrate.
Guerre mondiale ou développement économique ?
La lutte, entre les Démocrates et la majorité des Républicains, peut être lue comme un conflit entre deux tendances du capitalisme états-unien, entre celle porteuse de la mondialisation du capital et celle prônant une relance du développement industriel d’un pays économiquement déclinant. Les États-Unis étaient l’élément moteur et le principal bénéficiaire politique de l’internationalisation du capital. Suite à l’effondrement de l’URSS et l’état de sous-développement de la Chine, les USA ont été pendant vingt ans la seule superpuissance, un super-impérialisme qui organisait le monde à son profit. L’émergence de la Chine et la reconstitution politique de la Russie a brisé l’omnipotence économique et politique US.
L’enregistrement de ce fait a conduit à une opposition interne aux USA sur la marche à suivre : la fuite en avant dans la libéralisation des échanges ou le protectionnisme. Le problème n’est pas nouveau et a déjà été posé il y a plus d’un siècle par l’économiste autrichien Rudolf Hilferding qui, dans son ouvrage Le capital financier datant de 1910, constatait que « Ce n’est pas le pays du libre échange, l’Angleterre, mais les pays protectionnistes, l’Allemagne et les États-Unis qui devinrent les modèles du développement capitaliste » [6].
Nous sommes arrivés à une situation similaire. En 1910, le pays impérialiste dominant, l’Angleterre, était battu en brèche par les puissances économiques montantes. Aujourd’hui, c’est au tour des USA de voir leur suprématie économique remise en cause, principalement par la Chine. La Grande-Bretagne avait renoncé à être la puissance dominante, en se plaçant sous la « protection » des États-Unis. Ce scénario n’est pas de mise dans les relations futures entre les USA et la Chine, alliée à la Russie. Reste alors deux possibilités, celle d’un renouveau économique des USA sur une base protectionniste, tel qu’il est envisagé par une partie des Républicains, ou une conflictualité militaire de plus en plus ouverte, option qui semble être portée par le Parti démocrate.
Impérialisme vs ultra-impérialisme
Ainsi, la lutte, qui vient d’avoir lieu entre une partie des Républicains et les Démocrates, peut être lue comme un conflit opposant l’impérialisme états-unien et le super-impérialisme US. Dès lors les concepts, développés, au début du 20ème siècle, de par l’opposition entre Lénine et Kautsky, trouvent une nouvelle actualité. Kautsky considérait qu’à la guerre de 14-18 pourrait succéder une période, de développement du système capitaliste, caractérisée par le dépassement des contradictions entres les États et les différents groupes impérialistes, une période qu’il caractérise comme « ultra-impérialiste ». Il considérait que « de la guerre mondiale entre les grandes puissances impérialistes peut naître une alliance entre les plus grandes puissances qui mettra fin à la course aux armements » [7]. L’histoire s’est chargée de démentir cette thèse. Les conflits n’ont jamais cessés et une Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Depuis, un équilibre des forces entre deux super-puissances, les USA et l’URSS, a cependant empêché une montée aux extrêmes des différentes formes de guerre les impliquant. Cet équilibre va perdurer jusqu’au début des années 90. Depuis, suite à l’effondrement de l’URSS et l’état de sous-développement de la Chine, les USA ont été pendant vingt ans l’unique superpuissance, un super-impérialisme qui organisait et détruisait le monde selon ses intérêts. L’émergence de la Chine et la reconstitution de la Russie ont brisé la toute puissance économique et militaire US. La dernière guerre en Syrie est exemplative du cran d’arrêt mis au déferlement de la puissance militaire états-unienne.
En désindustrialisant le pays, le super-impérialisme états-unien a également affaibli la puissance des USA en tant que nation. Le projet initial de l’administration Trump était de procéder à une reconstruction économique. Les discours du nouveau Président sur une possible sortie de l’Otan, une réduction des interventions militaires US à l’étranger, ainsi que son opposition à une nouvelle Guerre froide avec la Russie rencontrent également cet objectif brisé par la victoire démocrate. La conséquence de leur succès est que si les USA renoncent à se développer, le seul objectif reste d’empêcher, par tous les moyens, les concurrents et adversaires de le faire.
[1] Arnaud Leparmentier, « Les gagnants et les perdants de la réforme fiscale de Donald Trump », Le Monde, 20 décembre 2017.
[2] Elsa Conesa « Trump : une réforme fiscale moins ambitieuse qu’elle en a l’air », Lesechos.fr, 16 décembre 2017
[3] Arnaud Leparmentier, Ibidem.
[4] Elsa Conesa, « Le nouveau projet américain de taxe aux frontières qui inquiète les entreprises françaises », Les Echos, le 3 novembre 2017.
[5] Heather Long « America’s 20 largest companies on the tax overhaul », December 21, 2017.
[6] Rudolf Hilferding, Le capital financier : étude sur le développement récent du capitalisme, Paris, Éditions de Minuit, 1970.
[7] Karl Kautsky, Der Imperialismus, Die Neue Zeit, 32ième année, n°2, p. 921, in Andrea Panaccione, « L’analyse du capitalisme chez Kautsky », Histoire du Marxisme contemporain, p.68, Institut Giangiacomo Feltrinelli, collection 10/18, Union Générale d’Éditions 1976.
L'Iran se montre impatient vis-à-vis de la politique contradictoire de l'Occident
Les analystes estiment que ces propos ne changent pas le principe de base de l'Iran rejetant l'influence des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Cela suggère toutefois que la dernière tentative de détente avec Washington --grâce à l'accord sur le nucléaire -- s'est essoufflée.
Cet accord a été conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne).
L'ayatollah Khamenei "a souligné à plusieurs reprises que l'accord de 2015 était un test pour voir si des négociations avec l'Occident pouvaient donner des résultats positifs", a déclaré à l'AFP Ellie Geranmayeh, du European Council on Foreign Relations.
"Les dirigeants iraniens estiment que les Etats-Unis agissent de mauvaise foi (...). La déclaration de l'ayatollah Khamenei est un feu vert à la concentration des efforts diplomatiques dans les relations avec la Chine et la Russie", a-t-elle ajouté.
Les déclarations de M. Khamenei vont de pair avec les menaces du président américain Donald Trump de sortir de l'accord nucléaire et de réimposer des sanctions à l'Iran s'il n'accepte pas de limiter son programme balistique et ses "activités" au Moyen-Orient.
Même avant Trump, l'Iran avait déjà le sentiment que Washington ne respectait pas ses engagements, en particulier à cause des sanctions non liées au nucléaire qui entravent, selon Téhéran, ses relations bancaires avec le reste du monde et les investissements étrangers.
Pour soutenir leur position, les responsables iraniens soulignent que l'accord nucléaire insiste sur le fait que les États-Unis doivent "s'abstenir de toute politique qui affecte directement ou de manière défavorable la normalisation des relations commerciales et économiques de l'Iran" avec le reste du monde.
"Dès le premier jour, les États-Unis, sous l'administration (de Barack) Obama, ont commencé à violer (...) l'accord", affirme Mohammad Marandi, analyste politique et professeur à l'université de Téhéran.
Selon lui, la déclaration de M. Khamenei souligne simplement que les relations avec les pays de l'Est et asiatiques sont beaucoup plus fortes aujourd'hui, en particulier depuis le rapprochement à travers le conflit syrien de l'Iran et la Russie, alliés indéfectibles de la Syrie.
"Les relations de l'Iran avec la Russie, la Chine et un nombre croissant de pays asiatiques sont aujourd'hui bien meilleures qu'avec les pays occidentaux parce qu'ils nous traitent beaucoup mieux", affirme M. Marandi.
Ainsi, la Chine est devenue le premier partenaire économique et commercial de l'Iran depuis plusieurs années.
Et selon des chiffres officiels sur les échanges commerciaux de Téhéran, entre avril et juillet (premier trimestre de l'année iranienne) 2017, la Corée du Sud se place au troisième rang des pays exportateurs vers l'Iran, la Turquie en quatrième position et l'Inde en cinquième position.
- Approche pragmatique -
La République islamique s'est montrée très flexible en matière de politique étrangère, estiment des analystes.
"L’Iran a adopté une approche pragmatique à l'égard des États-Unis lorsque ses intérêts le recommandaient", affirme Mme Geranmayeh.
Elle faisait notamment référence à la coopération avec Washington en 2001, au moment de l'invasion américaine de l'Afghanistan pour chasser les talibans du pouvoir.
Et en avril 2015, trois mois avant la conclusion de l'accord nucléaire, M. Khamenei avait laissé la porte ouverte à une amélioration des relations avec les Etats-Unis.
"Si l'autre partie cesse son obstination habituelle, (...) nous pourrons alors constater qu'une négociation est possible avec eux sur d'autres sujets également", avait-t-il déclaré.
Les exportations pétrolières de l'Iran ont plus que doublé depuis l'accord nucléaire, qui a permis la levée d'une partie des sanctions internationales, et le commerce avec l'Europe a bondi.
Mais les menaces américaines ont refroidi les investisseurs étrangers et les grandes banques internationales, les Européens restant plus vulnérables face aux pressions américaines que les Chinois ou les Russes.
"Si les Européens n'ont pas le courage de résister face aux États-Unis, ils ne doivent pas s'attendre à devenir nos partenaires", souligne M. Marandi.
"Si certaines portes se referment et d'autres s'ouvrent, nous n'allons pas attendre indéfiniment devant les portes fermées", dit-il encore.
L'Iran appelle le monde musulman à agir contre la décision US sur le statut de Qods
L'Iran appelle les musulmans à « agir sérieusement » contre le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville sainte de Qods.
Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, ce lundi 26 février, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué diverses questions d’ordre régional ou international.
En ce qui concerne la décision des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel-Aviv à Qods, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a affirmé que Washington paierait cher cette décision.

« C'est l'une des pires politiques des États-Unis dont ils vont payer le prix à l'avenir », a déclaré le diplomate.
Pour Qassemi, étant donné l'illogisme qui existe dans les décisions américaines, il y a grand besoin d'une action sérieuse du monde musulman.

Le 6 décembre dernier, le président américain Donald Trump a officiellement reconnu la ville de Qods comme capitale d'Israël et annoncé son intention d’y transférer l'ambassade américaine.
Qassemi a également émis l’espoir que le calme soit rétabli dans la Ghouta orientale de Damas, théâtre, en ce moment, de violents affrontements entre le gouvernement et des terroristes soutenus par des étrangers.
Qassemi a affirmé que la RII voulait une trêve à travers toute la Syrie afin que les aides humanitaires puissent y être transférés et distribués parmi les civils.
Le porte-parole a également fait allusion à l’opération militaire turque dans la région d'Afrin en Syrie, et ajouté qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères iranien, turc et russe, suivie par une autre réunion regroupant les chefs d’État de ces trois pays, aura lieu en mai en Turquie pour discuter de la situation en Syrie.
Selon le diplomate, Téhéran et Ankara ont eu des convergences comme des divergences sur diverses questions et l’important c’est de continuer les dialogues et coopérations dans le cadre des pourparlers pour résoudre la crise syrienne.
Qassemi a aussi fait allusion à la résolution anti-iranienne britannique qui devait être mise au vote ce lundi au Conseil de sécurité des Nations unies. « Cela s’avère en faveur des usurpateurs et aggravera la situation », a-t-il fait remarquer.
« Nous n'envoyons pas d'armes au Yémen ; de telles accusations répétitives viennent exactement de ceux qui attisent [les flammes] de la guerre et l'effusion de sang au Yémen », a-t-il dit.
Le porte-parole a ajouté que ce qui se passe au Yémen est le résultat des exportations d'armes britanniques et américaines vers l'Arabie saoudite.
L'Iran, a-t-il dit, observait le « comportement malhonnête » du gouvernement britannique, qui tente d'utiliser un mécanisme international pour soutenir l'envahisseur, malgré les appels à mettre fin à la guerre saoudienne.
Pour rappel, Londres et Washington ont fourni une grande quantité d’armes à l’Arabie saoudite dans la campagne militaire lancée depuis 2015 afin d’y faire retourner au pouvoir le président démissionnaire Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par Riyad, une guerre qui a coûté la vie à plus de 13 000 personnes.
Plan US pour éloigner la Turquie de l'Iran et de la Russie
Dans un récent numéro, le journal américain The Wall Street Journal s’attarde sur le plan américain visant à empêcher la Turquie de se tourner vers l’Iran et la Russie.
« Il y a cinq mois, le président américain Donald Trump saluait son homologue turc Recep Tayyip Erdogan comme étant un ami et déclarait que les deux alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) n'avaient jamais été aussi proches.
Mais la vision optimiste de Trump dissimulait une réalité bien plus compliquée: la Turquie est rapidement devenue l’une des relations diplomatiques les plus embarrassantes pour les États-Unis de Trump. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a récemment reconnu que les relations entre les deux pays étaient à un "point de crise". Et il semble qu'il n'y ait pas de feuille de route claire pour que les deux pays puissent surmonter leurs divergences. »
Selon le journal, l’administration Trump a lancé une nouvelle campagne pour essayer de rétablir les liens avec la Turquie et l’éloigner de la Russie et de l'Iran.
« Dans ce contexte, de hauts responsables américains, notamment le secrétaire d’État, Rex Tillerson, le conseiller à la sécurité nationale, le général H. R. McMaster et le secrétaire à la Défense, James Mattis, ont tenu des pourparlers intensifs avec les autorités turques pour tenter de dissuader Erdogan de ses relations chaleureuses avec Moscou et Téhéran.
À ce sujet, un haut responsable de l'administration Trump a même prétendu que le rapprochement de la Turquie avec l’Iran et la Russie allait à l'encontre des intérêts turcs. »
Selon le journal, les États-Unis craignent que la Russie, à travers la vente de batteries de missile à la Turquie, ne réussisse à diviser les membres de l’OTAN.
Bien que les officiels turcs aient refusé de commenter ces évolutions, les États-Unis et la Turquie se sont mis d'accord le week-end dernier pour former de nouveaux groupes de travail sur des questions clés afin d’examiner s'ils peuvent régler leurs différends, précise le journal.
« Nous préférons parler directement de ces questions avec les responsables américains », a laissé entendre un responsable turc.
Lire aussi : Syrie/Afrin: huit militaires turcs tués, l'armée confie la mission aux terroristes
Le président turc s'est entretenu, il y a quelques jours, avec ses homologues russe et iranien, pour préparer le terrain à une réunion prévue au printemps en Turquie pour discuter du conflit en Syrie ; or, les Américains rejettent tout plan russe pour travailler avec Téhéran et Ankara, sans les États-Unis, en ce qui concerne la crise syrienne, précise le journal, ajoutant :
« Dans l’optique de l'administration Trump, la principale question qui divise les États-Unis et la Turquie est le soutien américain aux combattants kurdes en Syrie. (…) Les responsables américains tentent de trouver un moyen de répondre aux préoccupations de la Turquie, mais n'ont pas encore trouvé les moyens de réinstaurer l’équilibre sur une donne de différences qui leur semblent irréconciliables.
Les États-Unis ont proposé d'établir des postes d'observation militaires conjoints en Syrie avec la Turquie, pour s'assurer que les combattants kurdes dans le nord de la Syrie n'attaquent pas la Turquie voisine. Et ils cherchent des moyens de réduire le pouvoir des combattants kurdes auxquels les États-Unis avaient eux-mêmes fourni des aides en argent, en armement et en entraînement militaire. »
Selon l’article du Wall Street Journal, en tout état de cause, l'administration Trump n'est pas disposée à satisfaire la revendication turque de cesser de travailler avec les YPG, les Unités de protection du peuple qu’Ankara considère comme terroristes.
Pour les autorités turques, le soutien américain aux YPG est une trahison. Les YPG constituent l'épine dorsale de la coalition militante arabo-kurde anti-Assad connue sous le nom de Forces démocratiques syriennes (FDS) ; or, Washington a demandé à la Turquie une liste des leaders kurdes qu’elle pourrait accepter de soutenir, ajoute le journal.