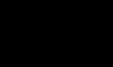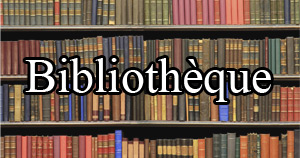Lorsque le confinement fut déclaré pour prévenir l’épidémie de Covid-19, nous avons averti que de profonds changements étaient en cours dans la région et que celle-ci ne ressemblerait plus après cette pause à celle que nous avons connue avant. Nous partions de l’observation selon laquelle Washington avait renoncé à détruire l’État en Syrie, désormais zone réservée de la Russie. Dès lors, la question principale était d’une part de savoir quelle serait la prochaine cible du Pentagone dans la région. Deux réponses étaient possibles : la Turquie ou l’Arabie saoudite, pourtant toutes deux alliées aux États-Unis. Et, d’autre part, quels marchés la Maison-Blanche allait-elle tenter d’ouvrir.
Cette analyse était partagée par tous ceux qui interprètent les vingt dernières années comme la mise en œuvre de la stratégie Rumsfeld/Cebrowski de destruction des structures étatiques du Grand Moyen-Orient. Elle était au contraire rejetée par ceux qui, refusant de prendre en compte les facteurs internationaux, interprètent naïvement les événements comme une succession de guerres civiles (Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Yémen et peut-être bientôt Liban) sans lien les unes avec les autres.
Or, trois mois plus tard, la Turquie est soutenue militairement par l’Iran en Libye, tandis que l’Arabie saoudite a disparu des radars, particulièrement au Yémen, et que les Émirats deviennent le pôle de stabilité régionale. Le basculement régional a débuté au profit d’Ankara et d’Abou Dhabi et au détriment de Riyad. Les transformations les plus radicales sont le revirement de l’Iran du côté de l’Otan, l’apaisement des relations USA-Turquie, et la montée en puissance des Émirats arabes unis. Nous avions donc raison et ceux qui accordent crédit à la narration des guerres civiles se sont auto-intoxiqués. Bien entendu, ils ne le reconnaitront pas et auront besoin de plusieurs mois pour adapter leur discours erroné aux réalités du terrain.
Il va de soi que chaque acteur devra ajuster sa position et que nos observations ne tiennent donc que pour aujourd’hui. Mais la région se transforme très rapidement et ceux qui réfléchiront trop longtemps pour réagir seront automatiquement perdants ; une remarque particulièrement valable pour les Européens. Enfin cette nouvelle donne est très instable et sera remise en question par Washington si le président Trump ne devait pas se succéder à lui-même, ou par Moscou si le président Poutine ne parvenait pas à conserver le Pouvoir à la fin de son mandat présidentiel, ou encore par Beijing si le président Xi persistait à construire des tronçons des Routes de la Soie en Occident.
Dans le plus grand silence médiatique, les Émirats arabes unis se sont désolidarisés de l’Arabie saoudite sur le champ de bataille yéménite. Ils ont appuyé des tribus qui ont exclu les troupes saoudiennes de leur pays. Ils occupent avec les Britanniques l’ile de Socotra, prenant le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb à la sortie de la mer Rouge. Ils ont de facto opéré une partition du Yémen, reprenant les frontières de la Guerre froide entre Yémen du Nord et Yémen du Sud [1].
L’Iran, malgré son différend frontalier avec les Émirats et la guerre qu’ils viennent de se livrer par Yéménites interposés, s’est trouvé satisfait de ce dénouement qui permet aux Houthis chiites d’obtenir un semblant de paix, mais pas encore de vaincre la famine. Acceptant finalement que Donald Trump ait été élu président des États-Unis, Téhéran a renoué contact avec Washington avec trois ans de retard. De manière spectaculaire, le gouvernement d’Hassan Rohani a annoncé soutenir militairement le gouvernement el-Sarraj en Libye [2]. Dans la pratique, cela signifie qu’il soutient les Frères musulmans (comme dans les années 90 en Bosnie-Herzégovine), la Turquie et l’Otan (comme lors du régime du shah Reza Pahlevi). Dans ces conditions, on ne voit plus ce que l’Iran fait en Syrie où il est censé se battre contre ses nouveaux alliés, les jihadistes, la Turquie et l’Otan.
Bien entendu, il faut conserver à l’esprit que l’Iran, comme le nouvel Israël, est bicéphale. Les déclarations du gouvernement Rohani n’engagent peut-être pas le Guide de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei.
Quoi qu’il en soit, le revirement de cette pièce maîtresse place le Hezbollah libanais en mauvaise posture. Il apparaît aujourd’hui que ce sont bien les États-Unis qui ont délibérément provoqué l’effondrement de la livre libanaise avec l’aide du gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé. Washington tente maintenant d’imposer à Beyrouth une loi US (Caesar Syria Civilian Protection Act) l’obligeant à fermer la frontière libano-syrienne. Pour survivre, le Liban serait contraint de faire alliance avec la seule autre puissance avec laquelle il partage une frontière terrestre : son ancien colonisateur, Israël [3]. Certes l’arrivée au pouvoir à Tel-Aviv d’une coalition bicéphale, alliant les partisans de l’ancien projet colonial britannique et ceux du nationalisme de la troisième génération d’Israéliens, ne permet plus d’invasion du Liban. Mais cette coalition est extrêmement fragile et un retour en arrière reste possible, sinon probable. La seule solution pour le Liban est donc de ne pas appliquer la loi US et de se tourner non plus vers l’Occident, mais vers la Russie et la Chine. C’est ce que sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a osé dire publiquement. Il considère que l’Iran —malgré son rapprochement avec la Turquie (présente au Nord du Liban avec les Frères musulmans [4]) et avec l’Otan (présente derrière Israël)— reste culturellement l’intermédiaire entre la Chine et l’Occident. Durant toute l’Antiquité et le Moyen-Age, on ne parlait pas les multiples langues locales tout au long de la Route de la Soie, mais le persan.
Historiquement le Hezbollah a été créé sur le modèle des Bassij de la Révolution iranienne dont il partage le drapeau. Cependant son armement, jusqu’au retrait syrien du Liban en 2005, lui venait de Damas et non pas de Téhéran. Il devra donc obligatoirement choisir entre ses deux parrains, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des motifs matériels. Sayyed Hassan Nasrallah est partisan du modèle laïque syrien, tandis que son adjoint, cheikh Naïm Qassem, est un soutien inconditionnel du modèle théocratique iranien. Mais l’argent se trouve à Téhéran, pas à Damas.
Quoi qu’il en soit, les Libanais font peut-être fausse route. Ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi Washington les accable car ils n’envisagent pas que les États-Unis et la Russie aient décidé d’appliquer le Yalta régional qu’ils avaient négocié en 2012 et qu’Hillary Clinton et François Hollande avaient fait capoter. Dans ce cas, Beyrouth pourrait avoir été inscrit à son insu dans la zone d’influence russe.
Une fois de plus et de manière constante depuis des siècles, certes les intérêts des puissances occidentales vont dans le sens de la laïcité, mais leur stratégie pour dominer la région les conduit inexorablement à s’appuyer sur les religieux contre les nationalistes (à l’unique et brève exception des USA en 1953).
La Syrie, encerclée par les alliés des États-Unis, n’a d’autre choix que de s’approvisionner en Russie, ce à quoi sa classe dirigeante rechigne depuis six ans. Cela ne deviendra possible qu’à la résolution du conflit qui oppose le président Bachar el-Assad à son lointain cousin, le milliardaire Rami Maklouf, et au-delà, à tous les oligarques syriens. Cette querelle ne doit rien à l’affaire de famille que décrivent les médias occidentaux. Elle doit être comparée à la reprise en main des oligarques russes par le président Vladimir Poutine, durant les années 2000, qui lui permit d’effacer les errements de la période Eltsine. Dix-sept ans d’embargos contre Damas n’auront que retardé cette inévitable épreuve de force. Ce n’est qu’une fois ce conflit résolu que Damas pourra envisager de recouvrir ses territoires perdus, le Golan occupé par Israël et Idleb occupé par la Turquie [5].
L’Iraq a été le second pays —après les Émirats— à avoir compris le changement iranien. Il a immédiatement conclu un accord avec Washington et le nouveau Téhéran pour nommer comme Premier ministre le chef de ses services secrets, Mustafa al-Kadhimi, bien que celui-ci ait été violemment accusé durant les six derniers mois par l’ancien Téhéran d’avoir activement participé à l’assassinat à Bagdad du héros chiite Qassem Soleimani [6]. L’Iraq ne devrait donc plus combattre la résurgence de ses groupes jihadistes (organisations mercenaires des Anglo-Saxons et désormais soutenues par l’Iran), mais négocier avec ses chefs.
Israël, seul État au monde à être désormais gouverné par deux Premiers ministres, ne pourra plus jouer le rôle d’extension des puissances anglo-saxonnes et ne pourra pas non plus devenir une nation comme les autres. Toute sa politique extérieure est paralysée au moment même où le Liban est affaibli et représente pour lui une proie de choix. Pour les partisans du projet colonial, unis derrière le Premier Premier ministre Benjamin Netanyahu et désormais en perte de vitesse, le changement de l’Iran est déjà visible en Iraq et en Libye. Il est urgent d’inventer un nouvel ennemi iconique pour se maintenir. Au contraire, pour les nationalistes israéliens, unis derrière le Deuxième Premier ministre Benny Gantz, il convient de ne jeter la pierre à personne et de négocier prudemment avec le Hamas (c’est-à-dire avec les Frères musulmans) [7].
L’Égypte reste focalisée sur son problème alimentaire. Elle ne parvient à nourrir sa population qu’avec l’aide saoudienne et planifie son développement avec l’aide chinoise. Elle est pour l’instant tétanisée par le recul saoudien et l’offensive antichinoise états-unienne. Elle poursuit pourtant son réarmement.
La Libye, enfin, n’existe plus en tant qu’État. Elle est divisée en deux comme le Yémen. Du fait de la victoire de l’Otan en 2011 et de l’absence de troupes US au sol, c’est le seul endroit de la région où le Pentagone peut poursuivre sans obstacle la stratégie Rumsfeld/Cebrowski [8]. Les récents succès militaires du gouvernement el-Sarraj (c’est-à-dire des Frères musulmans) —soutenu par la Turquie et désormais aussi par l’Iran— ne doivent pas faire illusion. Le gouvernement du maréchal Haftar —soutenu par les Émirats et l’Égypte— résiste. Le Pentagone entend faire durer le conflit le plus longtemps possible au détriment de toute la population. Il soutient les deux camps à la fois comme lors de la guerre Iraq-Iran (1980-88) et viendra toujours au secours du perdant qu’il abandonnera le lendemain.
Restent les deux grands perdants de la nouvelle donne : la Chine et l’Arabie saoudite.
L’influence chinoise s’arrête en Iran. Elle vient d’être stoppée par le secrétaire d’État Mike Pompeo en Israël. Beijing ne construira pas la plus grande usine de désalinisation du monde et ses projets aux ports d’Haïfa et d’Ashdod sont voués à l’échec malgré les immenses investissements déjà réalisés. Personne n’osera éliminer les 18 000 jihadistes chinois à la frontière syro-turque [9] de sorte que celle-ci restera toujours instable, fermant l’hypothèse du passage Nord de la Route de la Soie. Il ne restera donc que l’hypothèse du passage Sud, par le canal de Suez égyptien, mais celui-ci restera sous contrôle des Occidentaux.
Personne ne sait où en est l’Arabie saoudite. En trois ans, le prince Mohamed Ben Salmane (MBS) a su éveiller de fols espoirs en Occident et se mettre à dos la totalité des puissances de la région à force de pendaisons et de démembrement de ses opposants suivi de dissolution de leurs corps à l’acide. Son pays a dû battre en retraite au Yémen où il s’était imprudemment aventuré et renoncer à ses grands travaux, notamment la construction de la zone franche qui devait héberger les milliardaires du monde entier, Neom [10]. Ses gigantesques réserves de pétrole ne sont plus des objets de spéculation et ont perdu l’essentiel de leur valeur. La plus grande puissance militaire de la région n’est qu’un colosse aux pieds d’argile en passe d’agoniser dans les sables du désert qui l’ont vu naître.
En définitive, le président Donald Trump est en train de parvenir à ses fins : il a fait échouer le projet du Pentagone d’un État accordé à une organisation terroriste, Daesh, puis il est parvenu à faire réintégrer dans la zone économique US tous les États de la région à l’exception de la Syrie déjà perdue depuis 2014. Mais simultanément, le Pentagone aussi triomphe partiellement : il est parvenu à détruire les structures étatiques d’Afghanistan, d’Iraq, de Libye et du Yémen. Il a rencontré son seul échec en Syrie, certes en raison de l’intervention militaire russe, mais surtout parce que les Syriens incarnent le concept d’État depuis la nuit des temps.
L’annihilation des structures étatiques afghanes, selon le plan du Pentagone, et le retrait des troupes US qui sera effectif le jour de l’élection présidentielle US, selon la volonté du président Trump, auraient pu marquer l’alliance entre ces deux forces. Or, il n’en est rien. Le Pentagone a tenté en vain d’imposer la loi martiale aux États-Unis face à l’épidémie de Covid-19 [11], puis il a aidé en sous-main les « Antifas » qu’il avait déjà encadrés en Syrie [12] pour coordonner des émeutes prétendument « raciales ». La Russie, qui n’a jamais varié de position, attend sagement de récolter les lauriers de son engagement en Syrie.