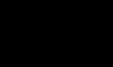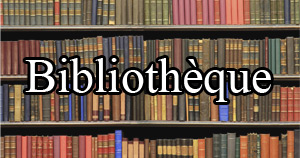Rien n’est jamais simple. Le changement d’administration à Washington devrait conduire à l’éradication des Frères musulmans et de l’ensemble des groupes jihadistes qu’ils ont formés. Le nouveau président n’a attendu qu’une semaine pour publier un Memorandum sur la manière de combattre réellement Daesh. Cependant, les alliés des États-Unis n’entendent pas s’aligner si facilement sur ce renversement à 180° d’une politique dont ils ont appris à tirer les dividendes.
Le Royaume-Uni envisage différentes options qui s’offrent à lui avec le Brexit : soit se rapprocher de la puissance économique montante, la Chine, soit rejouer l’alliance anglo-saxonne et former un directoire mondial avec les États-Unis. Problèmes : les Chinois ont un très mauvais souvenir de la colonisation britannique et montrent à Hong Kong qu’ils n’ont pas l’intention de poursuivre plus avant l’accord « Un pays, deux systèmes », tandis que les États-uniens espèrent substituer un rayonnement commercial à leur impérialisme militaire.
Donald Trump déclinant pour le moment l’invitation de Londres, la Première ministre Theresa May s’est précipitée outre-Atlantique. Lors d’un étonnant discours prononcé devant les élus républicains à Philadelphie, elle a rappelé l’Histoire commune des deux États et l’influence internationale du Commonwealth ; pour conclure qu’elle était prête à reformer avec le président Trump le couple Reagan-Thatcher qui domina le monde occidental durant les années 80.
Rencontrant le président Trump, la Première ministre s’est faite tout sourire. Elle s’est félicitée de l’annonce par son hôte d’un accord commercial bilatéral, le premier de son mandat. Cependant, celui-ci ne pourra entrer en vigueur qu’une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne, c’est-à-dire pas avant un à deux ans.
Pas certaine d’avoir convaincu, Madame May a poursuivi son voyage en Turquie. Lors de sa rencontre avec le président Recep Tayyip Erdoğan, elle a évidemment annoncé un développement du commerce bilatéral. Mais ce n’était pas l’objet de sa visite. L’essentiel des discussions ont porté sur la manière dont Londres et Ankara pourraient ensemble profiter de l’Union européenne, depuis l’extérieur.
Mais avant toute chose, elle a commencé par féliciter le dictateur d’avoir brillamment défendu la démocratie lors de l’abominable coup d’État du 15 juillet dernier ; en réalité une tentative d’assassinat du président Erdoğan commanditée par la CIA. À l’époque, déjà, l’ambassadeur britannique avait été le premier à retourner sa veste et à célébrer la victoire de l’« État de droit ».
La dernière idée du Foreign Office est de régler le conflit chypriote en obtenant des droits économiques particuliers pour la Turquie. De la sorte, Ankara pourrait jouir du marché commun européen sans adhérer à l’Union. Et il permettrait à Londres d’utiliser ce privilège pour continuer à commercer avec l’Union au-delà du Brexit. Une idée, certes astucieuse, mais qui ne respire pas la bonne foi et n’inspire pas la confiance que la même Mme May exige de Bruxelles pour négocier le Brexit.
Theresa May s’est inquiétée du rapprochement russo-turc, malgré l’antagonisme séculaire entre les deux parties. Ayant compris que les négociations d’Astana ne visaient pas à réconcilier les points de vue des Syriens, mais à permettre à la Turquie de faire un premier pas vers Damas, elle a cherché à troubler cette alliance naissante. À ses yeux, le problème n’était pas que M. Erdoğan se prépare à embrasser le président el-Assad après l’avoir longuement combattu, mais qu’il le fasse sous l’impulsion du grand rival russe.
À propos de la Syrie, Londres pourrait aider à lutter contre les Kurdes si Ankara lui laissait le contrôle des jihadistes ; une proposition totalement contradictoire avec celle faite aux « Américains ». Peu importe, c’est une habitude historique de la « perfide Albion » de tenir des discours différents selon ses interlocuteurs et de voir avec le temps ce qui fonctionne ou pas.