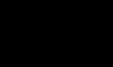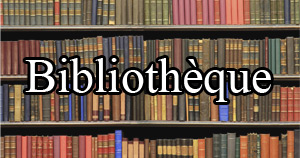Les États-Unis veulent faire accepter une intervention contre le Venezuela avec la complicité du « Groupe de Lima » qui se compose de 12 pays, soit moins de la moitié des membres de l’OEA (Organisation des États américains) parmi lesquels figure le Panama ; mais c’est une entreprise illégitime et impossible, dans la mesure où cela bafoue scandaleusement la Charte de l’OEA, celle de l’Onu, et le droit international.
La violation du droit international se pratique depuis qu’Hugo Chávez était arrivé au pouvoir au Venezuela, et que les États-Unis ont commencé à perdre là des privilèges et une véritable manne pétrolière.
Illégalité d’une intervention au Venezuela au regard de la Charte de l’OEA
L’OEA a perdu de son prestige, mais sa charte consacre bel et bien certains principes du droit international qui rendent impossible une intervention individuelle ou collective de ses membres dans les affaires internes et externes d’autres États ; ce sont, mutatis mutandi, les principes mêmes de la Charte de l’Onu, entre autres :
 1. Chaque État a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode d’organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres États. Sous réserve des dispositions précédentes, les États américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux (Article 3 e).
1. Chaque État a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode d’organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres États. Sous réserve des dispositions précédentes, les États américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux (Article 3 e).
 2. Les différends de caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs États américains doivent être réglés par des moyens pacifiques ; (Art. 3, i).
2. Les différends de caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs États américains doivent être réglés par des moyens pacifiques ; (Art. 3, i).
 3. Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent. (Art. 19).
3. Aucun État ou groupe d’États n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Le principe précédent exclut l’emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d’ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l’État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent. (Art. 19).
 4. Aucun État ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère économique et politique pour forcer la volonté souveraine d’un autre État et obtenir de celui-ci des avantages d’une nature quelconque. (Art. 20).
4. Aucun État ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère économique et politique pour forcer la volonté souveraine d’un autre État et obtenir de celui-ci des avantages d’une nature quelconque. (Art. 20).
 5. Le territoire d’un État est inviolable, il ne peut être l’objet d’occupation militaire ni d’autres mesures de force de la part d’un autre État, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire. (Art. 21).
5. Le territoire d’un État est inviolable, il ne peut être l’objet d’occupation militaire ni d’autres mesures de force de la part d’un autre État, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire. (Art. 21).
 6. Les États américains s’engagent dans leurs relations internationales à ne pas recourir à l’emploi de la force, si ce n’est dans le cas de légitime défense, conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de l’exécution desdits traités. (Art. 22).
6. Les États américains s’engagent dans leurs relations internationales à ne pas recourir à l’emploi de la force, si ce n’est dans le cas de légitime défense, conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de l’exécution desdits traités. (Art. 22).
 7. Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution des droits et obligations des États membres, et ce, conformément à la Charte des Nations unies. (Art. 131).
7. Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution des droits et obligations des États membres, et ce, conformément à la Charte des Nations unies. (Art. 131).
La charte dite démocratique de l’OEA ne saurait être invoquée contre le Venezuela parce que la « démocratie représentative » qu’elle prétend sacraliser entre en conflit avec l’article 103 de la Charte de l’Onu, qui prévaut sur celle de l’OEA.
« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
La Charte de l’Onu ne mentionne pas la « démocratie représentative » (objectif primordial de la Charte démocratique interaméricaine de l’OEA) en tant que modèle ou système politique obligatoire pour ses membres, parce qu’elle reconnaît qu’il existe de par le monde diverses formes d’organisation politique ou de gouvernement, telles que les républiques et les monarchies (démocratiques ou non, présidentialistes ou parlementaires), les principautés, etc.
Mais la République bolivarienne du Venezuela va bien au-delà des « démocraties représentatives » de la région, car le Venezuela est une démocratie participative, et c’est l’un des pays les plus démocratiques au monde, comme le prouvent son histoire et son expérience actuelle, tels que constatés par l’Onu, par des organismes internationaux des droits humains, par des personnalités et des associations prestigieuses, telle la Fondation Carter, entre autres.
Qui sont les membres du « Groupe de Lima » ?
Cependant les États-Unis et leurs satellites du Groupe de Lima persévèrent dans la violation du droit international, et cela malgré le fait qu’ils n’ont même pas obtenu au sein de l’OEA le soutien espéré pour cette aventure impérialiste, car les pays indépendants du bassin caraïbe et d’autres les en ont empêchés ; en effet, presque tous les membres du Groupe de Lima bafouent les normes qui pourraient permettre une gouvernance démocratique élémentaire.
 De quel droit les États-Unis se réclament-ils pour piller le Venezuela, alors que c’est le premier pays à violer la charte de l’Onu et le négateur absolu du droit international ? Les États-Unis constituent le pays qui a rejeté le plus grand nombre de traités relatifs aux droits humains, ou a refusé de les ratifier au plan mondial ; les États-Unis ont le plus grand nombre de condamnations à mort au monde ; le budget de la « Défense » y est plus élevé que celui des six États qui le suivent dans la liste ; c’est le pays qui a le plus de bases militaires au monde, plus de mille ; c’est le pays qui a divisé le monde en 10 zones de commandement militaire, sans autorisation ni consentement d’aucun des pays concernés ; c’est le pays qui accapare la plus grande part des richesses mondiales ; selon la FAO, il suffirait de 1 060 millions de dollars pour en finir avec la faim dans le monde, mais les États-Unis dépensent un milliard de dollars en guerres diverses.
De quel droit les États-Unis se réclament-ils pour piller le Venezuela, alors que c’est le premier pays à violer la charte de l’Onu et le négateur absolu du droit international ? Les États-Unis constituent le pays qui a rejeté le plus grand nombre de traités relatifs aux droits humains, ou a refusé de les ratifier au plan mondial ; les États-Unis ont le plus grand nombre de condamnations à mort au monde ; le budget de la « Défense » y est plus élevé que celui des six États qui le suivent dans la liste ; c’est le pays qui a le plus de bases militaires au monde, plus de mille ; c’est le pays qui a divisé le monde en 10 zones de commandement militaire, sans autorisation ni consentement d’aucun des pays concernés ; c’est le pays qui accapare la plus grande part des richesses mondiales ; selon la FAO, il suffirait de 1 060 millions de dollars pour en finir avec la faim dans le monde, mais les États-Unis dépensent un milliard de dollars en guerres diverses.
De quel droit cet État voyou refuse-t-il au peuple vénézuélien son droit à l’existence ?
 De quel droit la Colombie est-elle en tête de l’agression contre le Venezuela, alors que sur le plan extérieur, la Colombie est un pays occupé par les États-Unis (qui y ont implanté sept bases militaires) et qui ne jouit donc pas de l’indépendance ? Au plan interne, la Colombie est un narco-État dont un citoyen sur dix est contraint de vivre à l’étranger, suivi en cela par le Brésil et le Pérou ; la Colombie a trahi les Accords de paix signés avec la guérilla, assassine, et permet à des paramilitaires de liquider systématiquement les défenseurs droits des pauvres et des droits de l’homme. La Colombie tolère le harcèlement et l’agression de mouvements politiques qui participent à la politique nationale, comme les Farc.
De quel droit la Colombie est-elle en tête de l’agression contre le Venezuela, alors que sur le plan extérieur, la Colombie est un pays occupé par les États-Unis (qui y ont implanté sept bases militaires) et qui ne jouit donc pas de l’indépendance ? Au plan interne, la Colombie est un narco-État dont un citoyen sur dix est contraint de vivre à l’étranger, suivi en cela par le Brésil et le Pérou ; la Colombie a trahi les Accords de paix signés avec la guérilla, assassine, et permet à des paramilitaires de liquider systématiquement les défenseurs droits des pauvres et des droits de l’homme. La Colombie tolère le harcèlement et l’agression de mouvements politiques qui participent à la politique nationale, comme les Farc.
 De quel droit le Pérou allègue-t-il le manque de démocratie au Venezuela, alors que son président, Pedro Pablo Kuczynski, a failli se voir destitué par le Congrès pour « incapacité morale » à exercer le gouvernement, après avoir reçu des pots-de-vin d’Odebrecht, et avoir amnistié illégalement l’ex-président Alberto Fujimori, qui reconnaît avoir pratiqué le génocide, et tandis que le gouvernement péruvien est assiégé en permanence par des réclamations des travailleurs de la Santé et de l’Éducation ?
De quel droit le Pérou allègue-t-il le manque de démocratie au Venezuela, alors que son président, Pedro Pablo Kuczynski, a failli se voir destitué par le Congrès pour « incapacité morale » à exercer le gouvernement, après avoir reçu des pots-de-vin d’Odebrecht, et avoir amnistié illégalement l’ex-président Alberto Fujimori, qui reconnaît avoir pratiqué le génocide, et tandis que le gouvernement péruvien est assiégé en permanence par des réclamations des travailleurs de la Santé et de l’Éducation ?
 De quel droit l’Argentine remet en question la transparence au Venezuela, alors que le président Mauricio Macri est mouillé jusqu’au cou dans le scandale Odelbrecht et celui des Panama Papers [1] ? Son gouvernement est en butte aux réclamations quotidiennes du peuple, des indiens Mapuches, des retraités et des classes moyennes ; c’est un pays qui stagne, alors qu’il parvenait à remonter la pente du progrès sous le mandat de Cristina Kirchner.
De quel droit l’Argentine remet en question la transparence au Venezuela, alors que le président Mauricio Macri est mouillé jusqu’au cou dans le scandale Odelbrecht et celui des Panama Papers [1] ? Son gouvernement est en butte aux réclamations quotidiennes du peuple, des indiens Mapuches, des retraités et des classes moyennes ; c’est un pays qui stagne, alors qu’il parvenait à remonter la pente du progrès sous le mandat de Cristina Kirchner.
 De quel droit le Brésil offre-t-il son territoire comme tremplin pour une intervention et pour dénoncer la « dictature » au Venezuela, alors que le président non élu Michel Temer est parvenu à son poste grâce à un coup d’État « en douceur » contre la présidente Dilma Roussef, et qu’il est accusé par le Procureur général de l’État de « corruption passive, obstruction à la justice et organisation criminelle », tandis qu’il bloque de façon antidémocratique la candidature de Luis Inacio Lula da Silva à la présidence ?
De quel droit le Brésil offre-t-il son territoire comme tremplin pour une intervention et pour dénoncer la « dictature » au Venezuela, alors que le président non élu Michel Temer est parvenu à son poste grâce à un coup d’État « en douceur » contre la présidente Dilma Roussef, et qu’il est accusé par le Procureur général de l’État de « corruption passive, obstruction à la justice et organisation criminelle », tandis qu’il bloque de façon antidémocratique la candidature de Luis Inacio Lula da Silva à la présidence ?
 De quel droit le Mexique dénonce-t-il au Venezuela une « crise humanitaire » alors que le président Enrique Penia Nieto préside un gouvernement corrompu et qui ne se maintient que grâce au narcotrafic et au crime organisé, un gouvernement qui a livré les richesses du pays aux transnationales des États-Unis et alors que le Mexique possède le record mondial de journalistes assassinés et disparus ?
De quel droit le Mexique dénonce-t-il au Venezuela une « crise humanitaire » alors que le président Enrique Penia Nieto préside un gouvernement corrompu et qui ne se maintient que grâce au narcotrafic et au crime organisé, un gouvernement qui a livré les richesses du pays aux transnationales des États-Unis et alors que le Mexique possède le record mondial de journalistes assassinés et disparus ?
 Quant au Honduras, de quel droit conteste-t-il la légitimité de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, alors que son « président » inconstitutionnel et non élu mais installé au pouvoir par une fraude de dimensions cosmiques, José O. Hernandez, s’accroche au pouvoir en s’appuyant sur les baïonnettes du SouthCom des États-Unis [2] et fait tirer sans états d’âme sur son propre peuple ?
Quant au Honduras, de quel droit conteste-t-il la légitimité de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, alors que son « président » inconstitutionnel et non élu mais installé au pouvoir par une fraude de dimensions cosmiques, José O. Hernandez, s’accroche au pouvoir en s’appuyant sur les baïonnettes du SouthCom des États-Unis [2] et fait tirer sans états d’âme sur son propre peuple ?
Le cas particulier du Panama
De quel droit le Panama remet-il en question l’indépendance et la démocratie du Venezuela, alors que le Parti panaméen du président Juan Carlos Varela est arrivé au pouvoir dans les bras des envahisseurs, les États-Unis (qui avaient reconnu Guillermo Endara comme président du Panama sur une base militaire états-unienne), à la suite de l’invasion de 1989 [3] ? Il convient de se souvenir qu’en droit international, les accords signés sous occupation militaire sont ipso facto nuls et non avenus.
De quelle moralité se réclame le Panama pour détruire le droit du Venezuela à l’autodétermination alors que Guillermo Endara, le premier président fantoche en poste après l’invasion et président du Parti panaméen (le parti de l’actuel président Juan Carlos Varela) a souscrit à l’accord dit Arias Calderón-Hinton (1991) qui est à la base des traités Salas-Becker de 2002, traités qui ont livré le Panama à seize agences fédérales des États-Unis, parmi lesquelles le Pentagone, l’US Army, l’US Air Force, l’US Navy et le Service de garde-côtes des États-Unis ? Ces instances états-uniennes peuvent faire à nouveau de Panama une plateforme pour le SouthCom avec des objectifs d’agression.
De quel droit le Panama s’ingère-t-il dans les affaires vénézuéliennes, alors que les gouvernements panaméens ont toléré sans objection les manœuvres Panamax (2003-2018) réalisées tous les ans entre les pays de la région et les puissances membres de l’Otan sur la base d’un traité entre le Chili et les États-Unis ? Ce traité, signé en 2003, viole le Traité de neutralité et la Constitution panaméenne. Panama ne le reconnaît pas et ne l’a pas ratifié.
De quel droit le président panaméen Juan Carlos Varela a-t-il souscrit aux accords « Nouveaux Horizons 2018 », qui peuvent servir à couvrir une intervention contre le Venezuela, dans la mesure où ce traité bafoue le Traité de neutralité, la Constitution du Panama et le droit international ?
De quel droit le président du Panama peut-il entreprendre des actions contre le Venezuela, dans la mesure où les traités Salas-Becker, dont font partie les accords Nouveaux Horizons, n’ont jamais été soumis à l’approbation de l’Assemblée législative ou nationale panaméenne, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation constitutionnelle pour leur application ?
L’ex-présidente du Panama, Mireya Moscoso, membre du Parti panaméen, s’est déshonorée en souscrivant à la totalité des traités Salas-Becker (entre 2001 et 2004, à l’exception de celui de 1991) et en amnistiant illégalement, sur la demande du général Colin Powell (qu’on appelle « le boucher du Panama [4]), le terroriste avoué Luis Posada Carriles, qui avait tenté d’assassiner le président cubain Fidel Castro en 2002. Cette amnistie a été annulée par la Cour suprême de justice après qu’il en ait profité pour disparaître.
L’ex- président Moscoso est celui qui avait autorisé le traité Alemán-Zubieta-Becker (du 1er avril 2002), signé par l’administrateur de l’autorité chargée du Canal, Alberto Alemán Zubieta, qui n’était nullement habilité à signer des traités et qui, le comble, l’a entériné et signé en anglais, alors que la Constitution consacre l’espagnol comme la langue officielle de Panama : tous deux ont donc outrepassé leurs prérogatives (voir la Constitution nationale de la République du Panama, art. 191).
Nonobstant l’incapacité morale ou légale du groupe de Lima pour attaquer le Venezuela, les États-Unis insistent pour l’envahir avec la complicité de gouvernements non représentatifs, anachroniques, délinquants et ennemis du droit international, en profitant du carnaval de ces jours-ci (mardi 20 février) qui fait diversion, tandis qu’ils se déhanchent dans le sillage de leur dieu Momo, les États-Unis, sous le drapeau infâme d’une nouvelle « intervention humanitaire ».
Le détournement de la « responsabilité de protéger » sous un prétexte humanitaire
On veut nous faire croire qu’il y a au Venezuela une « crise humanitaire » qui exige de faire s’affronter les peuples de la région entre eux, des pauvres contre d’autres pauvres, des frères contre leurs frères, pour satisfaire les appétits de Washington, en interprétant au profit des États-Unis les recommandations du génial stratège chinois Sun Tzu, qui conseillait d’économiser ses propres forces et utiliser celles d’autres peuples.
Les interventions humanitaires, qui répondent à la nécessité de protéger les victimes des guerres, quand n’existe ni volonté, ni capacité, de la part du souverain pour assumer cette responsabilité, ont été détournées par les pouvoirs hégémoniques afin de masquer leurs vilenies prédatrices [5]
Personnellement je me suis opposé, en tant que président de la SERPAJ-Panama, à l’adoption en bloc du projet, lors de la réunion de l’Onu en Amérique centrale (San José, 2005), convoquée par la Fondation Arias. Parfois on confère le « droit de protéger » inhérent à l’intervention humanitaire au Conseil de sécurité de l’Onu, à une entente régionale comme l’Otan ou à un groupe d’États.
En Yougoslavie avait été mise en place une « intervention humanitaire » censée empêcher un nettoyage ethnique que Slobodan Milosevic aurait mis en œuvre en Bosnie, mais l’Otan (autrement dit les États-Unis), avait envahi la Yougoslavie, seul pays européen qui n’était pas membre de cette organisation militaire, l’avait démembrée en fonction des intérêts géopolitiques de l’Empire, et l’a plongé dans la ruine.
La vérité est apparue trop tard :
« Dix ans après que Slobodan Milosevic, ex-président de la Yougoslavie disparu, fut retrouvé mort dans des circonstances étranges (alors qu’il était en détention), la Cour pénale internationale a exonéré l’homme politique serbe de la responsabilité des crimes de guerre supposément commis en Bosnie…
Slobodan Milosevic a été vilipendé de façon systématique par toute la presse occidentale et par la classe politique des pays de l’Otan. Les moyens de communication de l’époque l’avaient qualifié de « boucher des Balkans » et comparé à Hitler. Il avait été accusé illégalement de génocide, en tant que « monstre assoiffé de sang », faisant les gros titres des principaux médias européens et états-uniens d’alors.
C’est grâce à ce cliché falsifié qu’on tenta de justifier les sanctions économiques contre la Serbie mais aussi les bombardements de l’Otan en 1999 sur la Serbie, ainsi que la guerre acharnée contre le Kosovo [6]. »
En Libye, fut mise en place une « intervention humanitaire » destinée à en finir avec la violation des droits de l’homme perpétrée par le « dictateur » Mouammar Kadhafi. Mais l’Otan appliqua son « droit de protection » à la population « sans défense ». En sept mois, 40 000 bombes et missiles furent largués sur la population, et avec l’aide d’espions, de terroristes et de mercenaires étrangers, 120 000 Libyens furent tués ; on assassina Kadhafi de façon atroce et particulièrement perverse, les actifs et le pétrole du pays furent expropriés, et le pays sombra dans un enfer perpétuel ; les Libyens « à la peau sombre » furent éliminés du gouvernement malgré le fait que le Conseil des droits humains à l’Onu avait félicité précisément cette année-là (en 2011) Kadhafi pour les progrès de la Libye en matière d’égalité raciale. C’est plus tard que l’on apprit que la tentative de Kadahafi pour remplacer le dollar par une monnaie commune africaine constituait l’une des raisons véritables de l’intervention « humanitaire ».
Dans le cas du Panama, les États-Unis n’ont même pas pris la peine d’informer l’OEA ni l’Onu, encore moins le Sénat états-unien, qu’ils seraient tenus d’approuver l’invasion de 1989, mais le général Manuel Antonio Noriega fut diabolisé à coup de mensonges, ce qui ressort de documents « secrets et sensibles » du Conseil de sécurité nationale états-unien, documents qui fixaient comme objectif l’abrogation des traités sur le canal et le projet de mettre un terme aux négociations entre le Japon et Panama en vue de l’ouverture d’un nouveau canal. [7].
Mais au Venezuela il n’y a pas de crise humanitaire ni de guerre civile, pas plus qu’il n’y en avait au Panama. Il y a une intervention externe dans les affaires internes et externes du peuple, une intervention qui se manifeste sous forme de guerres ultramodernes et multiformes, avec l’appui transnational d’États, d’organisations non-gouvernementales et de personnalités qui tentent de détruire la Nation vénézuélienne, d’abolir les conquêtes de sa Révolution et de lui voler ses prodigieuses richesses naturelles.
Une intervention contre le Venezuela serait une agression contre l’Amérique latine et le Bassin caribéen, un retour en arrière dans la construction de l’unité latino-américaine, un coup porté à la mémoire des libertadores de Notre Amérique ; pour toutes ces raisons, une telle intervention est juridiquement impossible et ne saurait réussir.